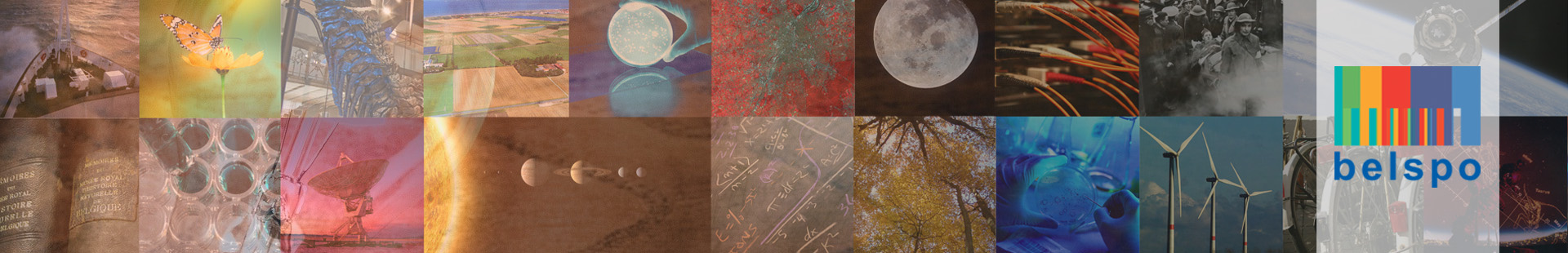

Projet de recherche TA/00/27A (Action de recherche TA)
Description :
L’objectif général du projet est de présenter une vue d’ensemble des inégalités sociales et de comprendre leur lien avec le cycle de vie des individus, et cela au cours des dernières décennies, en Belgique et au Luxembourg. Il est organisé en deux phases, chacune avec des objectifs différents.
Description des principaux objectifs de la phase I :
1.Identifier les groupes sociaux en classant les individus selon leur position sur le marché de l’emploi, leur niveau d’instruction, la composition de leur ménage, les caractéristiques de leur logement et de leur environnement proche, leur santé et leur nationalité. Seules les personnes en âge d’activité et pensionnées seront analysées (en excluant donc les enfants et les étudiants).
Une typologie des groupes sociaux sera établie par le réseau selon la nature et « l’intensité » de leurs situations de précarité. Cette « échelle sociale » ira des “groupes durs”, les plus précarisés car cumulant tous les handicaps à des groupes qui cumulent tous les atouts. Il importe de prendre ces derniers en considération, non seulement pour dresser un portrait social complet de la société, mais également parce que dans le contexte actuel de fortes instabilités professionnelle et familiale, le risque de relégation sociale n’est pas nul, même pour les groupes les plus favorisés. Cette typologie permettra de dresser, dans une optique transversale, un état des lieux des inégalités sociales à différents moments. Les chercheurs pourront ainsi vérifier si celles-ci ont changé de visage sociodémographique. Dans un contexte de vieillissement démographique, de transformation familiale et de multiculturalité, on peut supposer que les groupes les plus précarisés aujourd’hui ne sont pas les mêmes qu’hier.
Les recensements de la population et des logements de 1970, 1981, 1991 et 2001 feront l’objet de ces analyses.
2. Explorer et expliquer les changements de caractéristiques prises en compte dans l’étude (la santé et l’environnement perçu ne sont disponibles qu’en 2001) qu’ont enregistrés les individus dans chacun des groupes sociaux. Cette analyse longitudinale sera opérée prospectivement pour les groupes sociaux identifiés en 1991 et rétrospectivement pour ceux identifiés en 2001. Il en résultera des matrices de transition, permettant d’identifier les situations menant à une précarisation ou celles permettant d’en sortir. Dans la suite du projet, ces matrices seront déterminantes puisque : a) elles peuvent être calculées pour différents groupes de population (par exemple des générations, des individus d’entités spatiales ou d’environnements différents) et comparées par la suite ; b) la distribution des événements vécus par des individus expérimentant une même transition peut être analysée et comparée à celle des personnes en ayant expérimenté une autre.
3. Explorer les relations entre inégalités sociales et localisation spatiale. Cette analyse, qui représente une part importante et originale du projet, sera scindée en quatre axes de recherche qui correspondent à 4 objectifs sécondaires:
3.1 Localiser, au niveau spatial, les groupes sociaux. Vivent-ils dans les mêmes communes et types d’environnement perçu lors de chaque année de recensement ? Le lien entre inégalités sociales et ségrégation spatiale se renforce-t-il ? Les différents groupes sociaux étudiés se côtoient-ils dans l’espace ou occupent-ils chacun leur propre espace ? Des changements en termes d’environnement peuvent-ils être mis en relation avec les différentes politiques de lutte contre la pauvreté, notamment européennes ? Enfin, y a t il des différences sociodémographiques au sein même des groupes sociaux selon leur localisation spatiale? Les cas des logements sociaux et des résidences permanentes de type camping feront l’objet d’analyses particulières.
3.2 Identifier et analyser les effets de l’environnement proche sur les différents groupes sociaux. Cette analyse vise à mesurer de quelle manière les caractéristiques de l’environnement expliquent les changements de position des individus. Cela implique la comparaison des changements de position pour des individus appartenant au mêmes groupes sociaux mais vivant et restant dans des types d’environnement différents.
3.3 Identifier les relations entre la mobilité résidentielle et les changements en terme de précarité, pour les individus migrant d’un type de logement et d’environnement vers un autre au cours de la période intercensitaire. La mobilité est un droit qui s’accompagne d’une limitation de fait, car tout le monde n’a pas les moyens de ses aspirations. Les chercheurs tenteront de mettre en évidence les mécanismes qui génèrent une certaine sélectivité des dynamiques résidentielles et les changements qui, au cours de la vie des individus et des ménages, permettent de faire sauter le verrou de la mobilité ou contraignent à une mobilité spatiale descendante.
3.4 Mettre en évidence les différences entre milieux ruraux, anciennement industriels et tertiaires, de même que l’impact de la hiérarchie urbaine et les effets des changements économiques régionaux au cours de la période d’étude, en comparant les groupes sociaux et leurs évolutions dans différents contextes socio-spatiaux. Concrètement, cette comparaison portera sur trois types d’espaces géographiques. Type I concernera deux des trois capitales européennes, à savoir Bruxelles et Luxembourg-Ville ; il visera à mettre en évidence les formes d’inégalités sociales particulières qui s’expriment dans des métropoles marquées par une surreprésentation des emplois hautement qualifiés. Type II se focalisera sur les villes de bassin minier (Charleroi, Genk, Esch/alzette), marquées par une forte population ouvrière et/ou de faible niveau d’éducation et des problèmes sociaux liés à leur reconversion économique. Type III étudiera les zones frontalières des deux pays, zones placées sous l’influence du phénomène de métropolisation luxembourgeoise (effets socio-spatiaux du travail frontalier, notamment dans la province belge du Luxembourg). Chaque axe de comparaison sera traité à travers la confrontation des données diachroniques issues des recensements nationaux et de données administratives complémentaires (Sécurité Sociale au Luxembourg, Registre National en Belgique).
Objectifs de la phase II du projet :
1. Replacer les résultats de cette analyse exploratoire dans le contexte de changements sociétaux plus larges. Ces changements ont eu lieu au cours des dernières décennies et concernent le vieillissement de la population, la seconde transition démographique (diversification et instabilité croissantes de la structure des ménages), la prise de conscience de la problématique genre ou encore la multiculturalité.
2. Etudier les relations entre inégalités sociales, précarité et analyse inter- et intragénérationnelle ;
3. Confronter l’ensemble de l’analyse au cadre théorique issu du concept de mode d’intégration économique de Karl Polanyi afin de traduire les résultats en un ensemble synthétique et cohérent.
Résultats attendus au terme de la phase I du projet :
1. Mieux connaître les processus générant les inégalités sociales dans le temps.
2. Réussir une meilleure compréhension des interactions entre la production des inégalités sociales et l’ancrage spatial. L’espace, défini ici comme l’environnement proche des individus en termes de caractéristiques physiques et sociales du quartier, en ce compris la situation et les conditions de production de ce quartier au sein d’un contexte urbain ou régional plus large. Cette connaissance peut être cruciale pour une meilleure compréhension des effets des politiques sociales et territoriales de lutte contre les inégalités sociales.
3. Enrichir le cadre théorique sur base des résultats empiriques. Ces derniers permettront en effet d’identifier des concepts liant modes d’intégration économique et inégalités sociales dans les champs étudiés. Les matrices de transition permettront de calculer des probabilités de stabilité, de relégation ou de promotion sociale en fonction du niveau d’éducation, de l’emploi, du logement, etc.…