






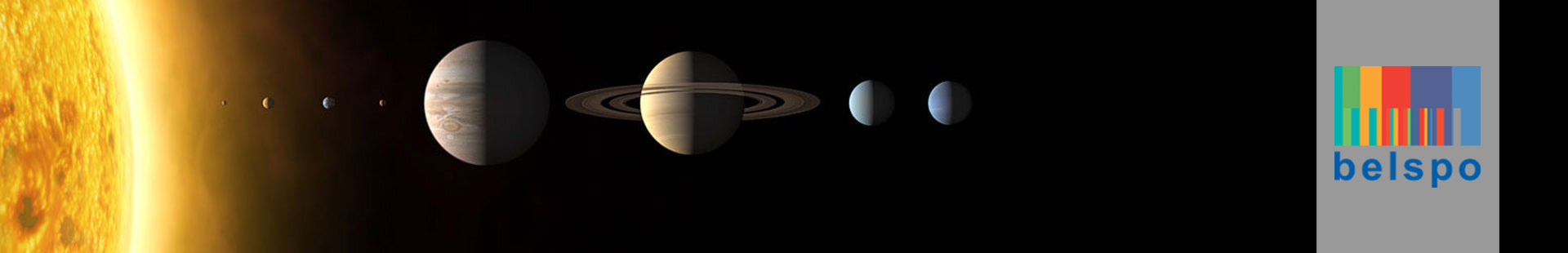

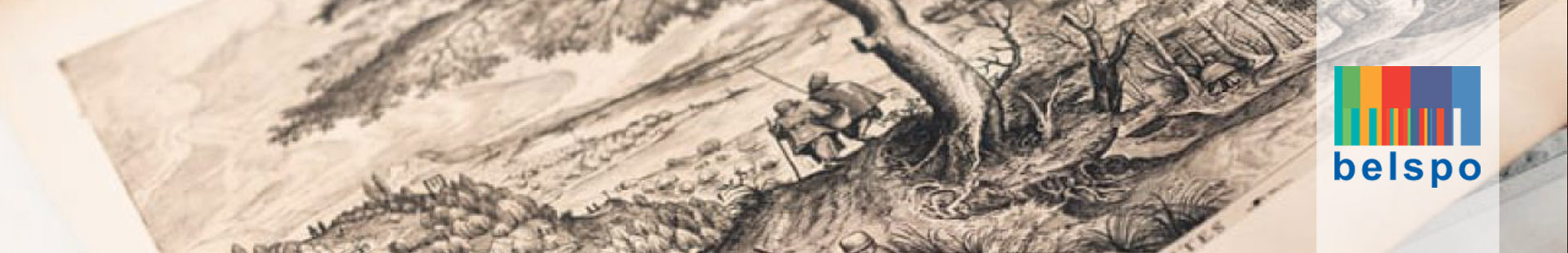
D'une manière générale, le terme « science citoyenne » fait référence à la participation du public à la recherche scientifique, souvent en collaboration avec des scientifiques professionnels ou sous leur supervision. Elle couvre un large éventail d'activités (formulation de questions de recherche, collecte de données, observations, comptage, interprétation des données, analyse, transcription de textes, publication et diffusion des résultats). En outre, la science citoyenne est une approche du travail scientifique qui peut être utilisée dans le cadre d'une activité scientifique plus large.
La European Citizen Science Association a publié 10 principles of citizen science, qui sont les suivants:
La science citoyenne et Crowdsourcing
Dans le cas de certains projets de science citoyenne, le crowdsourcing en particulier est parfois mentionné (pensez au projet «Did You Feel It?» de l’Observatoire royal de Belgique). Alors que la science citoyenne fait référence à la participation du public à des projets scientifiques, le crowdsourcing est l’engagement d’un grand groupe de personnes dans la création de nouvelles connaissances scientifiques – c’est donc un moyen spécifique d’inclure le public dans les projets.
La participation et l'engagement du public sont de plus en plus présents dans le paysage scientifique. Alors que les scientifiques étaient autrefois des personnages inatteignables et mystérieux, cachés dans un laboratoire ou loin lors d'une expédition, ils sont aujourd'hui plus accessibles et visibles pour le public. En outre, l’ambition est de stimuler la recherche en fonction des besoins des citoyens. Pour garantir une recherche inclusive, démocratique et percutante, la participation du public est essentielle. En outre, une participation effective du public joue un rôle important pour éclairer l’élaboration des politiques et l’innovation sociale pertinente – là où il existe un plus grand potentiel d’adoption des politiques et de changement effectif.
Différents types d'engagement du public existent : communication scientifique, co-conception, co-création et co-évaluation. Les trois derniers sont tous des « initiatives de participation ». Ceux-ci vont au-delà de la simple information et communication aux citoyens, mais les impliquent dans la prise de décision et les processus de R&I. La collaboration et la participation sont essentielles à ces initiatives.
Coconception (Co-design) : Dans le cas de la coconception, les citoyens sont encouragés à identifier les besoins et les priorités en matière de R&I. Les enquêtes, les groupes de discussion et les assemblées de citoyens sont souvent utilisés comme outils.
Cocréation (Co-creation) : Dans le cas de la cocréation, les citoyens participent à la production de résultats tangibles. Souvent, les défis locaux sont abordés et une mise en œuvre plus rapide est observée. La Science Citoyenne est une composante de la co-création. Citizen Science veille à ce que les citoyens puissent participer à la recherche en collectant des données (pensez à la signalisation des phénomènes météorologiques pour le IRM) ou à l'analyse des données (pensez au projet Radio Meteor Zoo de l’IASB). Le public participe parfois aussi activement à l'élaboration des questions de recherche.
Coévaluation (Co-assessment) : En cas de coévaluation, l’accent est mis sur l’évaluation des résultats de la R&I avec les parties prenantes afin de garantir la pertinence et l’acceptation sociétales.
